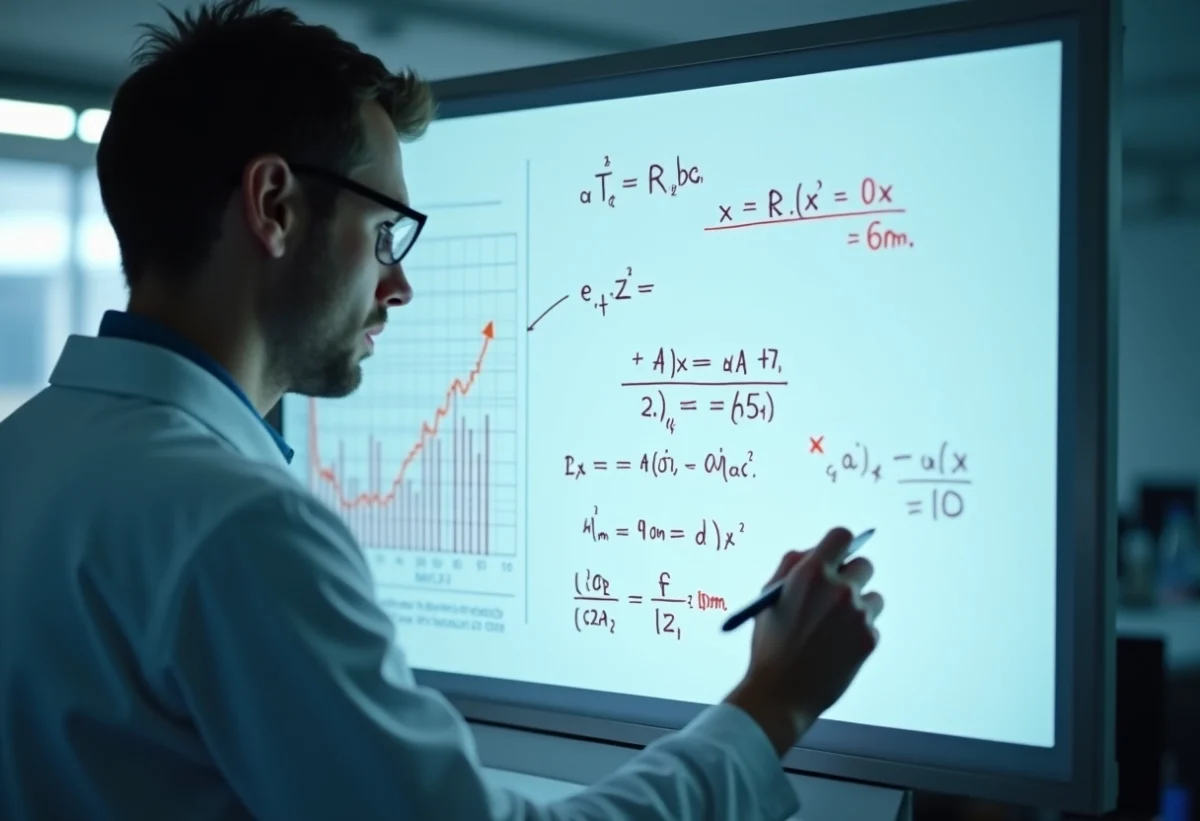En France, une coopérative n’a pas toujours le droit de distribuer ses excédents comme elle l’entend, même si ses membres y consentent. L’obligation de réinvestir la majorité des bénéfices dans le projet collectif s’impose à la plupart des structures relevant d’un cadre spécifique.
Certaines associations peuvent exercer une activité commerciale sans perdre leur caractère non lucratif, à condition de respecter des règles strictes qui encadrent leur gouvernance et l’utilisation de leurs ressources. Les normes applicables varient selon la taille, le statut juridique et le champ d’action des acteurs concernés.
ess : un modèle économique au service de l’intérêt collectif
L’économie sociale et solidaire (ESS) ne se contente pas d’occuper une case dans la vaste mosaïque économique. Elle propose une autre façon de concevoir la production, la répartition et l’utilisation des richesses. Depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, l’ESS fédère entreprises, associations, coopératives, mutuelles et fondations autour de deux piliers : solidarité et utilité sociale. Ici, les ambitions individuelles cèdent la place à l’intérêt général : il s’agit de répondre collectivement à des défis de société qui résistent à la logique purement marchande.
Animée par un socle de valeurs partagées, l’ESS se distingue par une gouvernance ouverte et une gestion qui refuse la logique d’enrichissement personnel. Ces organisations réinjectent l’essentiel de leurs excédents dans leur projet commun. Cette philosophie irrigue tous les secteurs : action sociale, santé, éducation, environnement, finance solidaire, aucun domaine n’échappe à cette dynamique.
La France accorde à l’ESS une place reconnue, soutenue aussi bien par l’ONU que par l’Union européenne. Aujourd’hui, ce modèle représente près de 10 % du PIB et 14 % de l’emploi privé national. Le foisonnement des acteurs est frappant : associatifs majeurs, mutuelles historiques, coopératives agricoles ou start-up innovantes, tous enrichissent ce paysage.
Pour mieux comprendre ce qui rend l’ESS singulière, voici les caractéristiques qui structurent son identité :
- Utilité sociale placée au centre de l’activité
- Solidarité comme moteur de l’organisation
- Cadre légal posé par la loi de 2014
- Reconnaissance internationale (France, ONU, Union européenne)
Ce mouvement, loin de la marge, façonne le visage de l’économie française et prouve chaque jour qu’il est possible d’allier efficacité et engagement collectif.
quels sont les principes et valeurs qui fondent l’économie sociale et solidaire ?
L’économie sociale et solidaire repose sur une structure claire : utilité sociale, gouvernance démocratique et gestion désintéressée. Ici, la quête du profit personnel n’a pas sa place. Les excédents servent à consolider le projet commun, à stimuler l’innovation sociale, à répondre à des besoins négligés par l’économie classique.
La gouvernance démocratique s’incarne dans les règles du jeu au quotidien. Une voix par personne, quelle que soit la part détenue ou le statut. Associations, coopératives, mutuelles : toutes appliquent ce principe. Cette horizontalité n’est pas qu’un mot, elle favorise l’implication de chacun et ancre les structures dans leur territoire.
L’utilité sociale guide la vocation des structures : insertion professionnelle, lutte contre l’exclusion, accès aux soins, mobilité durable, économie circulaire… Les initiatives se multiplient pour inventer des réponses inédites, renforcer les solidarités concrètes, expérimenter de nouveaux modèles, et entraîner leur écosystème vers des pratiques plus responsables.
Pour illustrer ces principes, voici ce qui caractérise le fonctionnement des structures de l’ESS :
- Gestion désintéressée : les bénéfices restent au service du collectif
- Innovation sociale : création de solutions originales face aux enjeux actuels
- Transparence et responsabilité dans la gestion des activités
La force de l’ESS réside dans cette architecture, portée par la loi française et animée par une volonté de repenser le sens même de l’économie.
panorama des acteurs, structures et secteurs d’activité de l’ESS
Le paysage de l’économie sociale et solidaire est riche et pluriel. Les associations en constituent la structure de base : elles dominent en nombre et agissent dans le social, le médico-social, l’éducation, la culture ou le sport. À leurs côtés, les coopératives fonctionnent sur le mode de l’autogestion et du partage des résultats, que ce soit pour produire, consommer ou se loger.
Les mutuelles jouent un rôle central dans la santé, la prévoyance et l’assurance, en s’appuyant sur la solidarité entre adhérents. Les fondations mobilisent des ressources privées pour servir l’intérêt général, notamment dans la recherche, l’action sociale ou l’environnement. Quant aux entreprises sociales et à certaines sociétés commerciales ayant adopté le statut ESS, elles affirment une utilité sociale claire et un mode de gestion responsable.
La variété des domaines couverts prouve la vitalité de cette dynamique : action sociale, environnement, économie circulaire, insertion par l’activité, finance solidaire, mobilité durable. Quelques structures emblématiques donnent la mesure de la diversité : Croix-Rouge française, Emmaüs, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, Fondation Abbé Pierre, Too Good To Go. Toutes illustrent la capacité de l’ESS à associer innovation, proximité et impact collectif, tout en pesant 10 % du PIB et 14 % de l’emploi privé en France.
entreprendre dans l’ESS : démarches, accompagnement et ressources utiles
Se lancer ou développer un projet dans l’économie sociale et solidaire implique de naviguer dans un univers dense où l’utilité sociale s’impose comme fil conducteur. Dès les premiers pas, il faut s’assurer que le statut juridique choisi colle aux exigences de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Ce cadre légal conditionne la possibilité d’obtenir l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), véritable sésame pour accéder à des financements publics et privés réservés aux structures à forte utilité sociale.
Le parcours du créateur s’appuie sur un maillage d’acteurs spécialisés. Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) jouent un rôle clé, de la structuration du projet à l’appui au développement. Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) propose pour sa part un accompagnement personnalisé, voire un prêt à taux zéro en cas de difficulté. Certaines fédérations nationales, Mouvement associatif, Coop FR, Fédération des entreprises d’insertion, apportent conseils, expertise et mise en relation avec l’ensemble de l’écosystème.
Pour vous orienter dans ce champ, voici quelques ressources structurantes :
- Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale (CNCRES) : coordination et observation à l’échelle nationale
- Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) : ressources et plaidoyer pour soutenir la création sociale innovante
- Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) : expertise santé et protection sociale
À chaque étape, il existe un relais, un appui, une ressource adaptée, que ce soit pour l’ingénierie juridique, le financement ou l’accompagnement. Ce maillage dense témoigne de la vitalité de l’ESS et de la mobilisation de ses réseaux pour soutenir chaque initiative, encourager l’innovation et garantir la continuité des activités.
L’ESS dessine un autre visage de l’économie : ouvert, collectif, ancré sur le terrain. À chaque projet, une nouvelle brique se pose à cette construction commune, et, demain, la vôtre pourrait bien faire la différence.